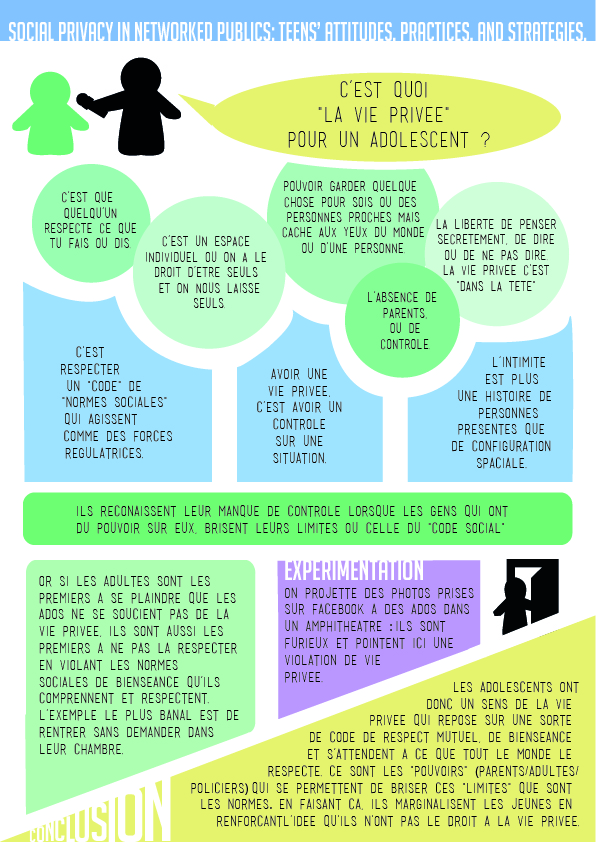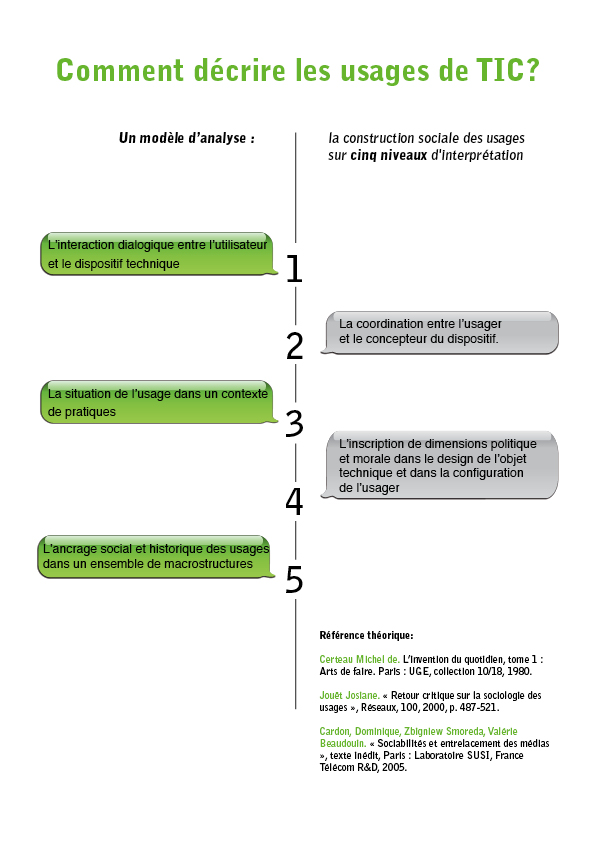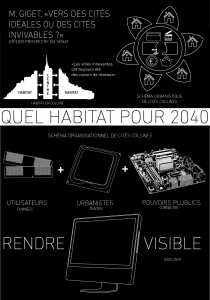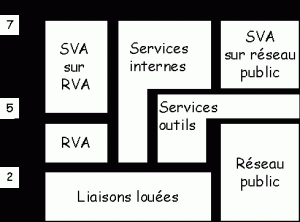Quelles relations entre la grammaire numérique et les contenus (images, sons, textes) auxquels ces technologies nous donnent accès ? Quelle modification de nos usages d’intégration des connaissances cette grammaire numérique implique-t-elle ? Les outils que le numérique met à notre disposition pour mettre en forme comme pour transmettre toutes sortes de contenus culturels les remodèlent furtivement, sans que nous en ayons totalement conscience. Si aucune technique ne peut se vanter d’être vraiment neutre, il est à noter que les technologies numériques ont la particularité de permettre de tout produire (images, textes et sons), rassembler, représenter et transmettre sur un même support. Mais cette unification des média en un seul ne gomme-t-elle pas les particularités de chacun ? Cette utilisation de plus en plus systématique du numérique comme moyen de culture de l’esprit est-elle justifiée, à partir du moment où il n’a pas principalement été pensé pour cela ?
Voici réunis des articles, vidéos de conférences, références de livres, qui donnent différents éclairages sur cette question du croisement entre technique et connaissance. Les deux premiers nous rappellent que la technique ne peut être considérée comme un outil neutre, silencieusement asservi à la volonté de son utilisateur humain. Cette vidéo de Delphine Gardey lors d’un colloque donne un aperçu de son travail historique sur l’évolution des techniques d’écriture et de classement, et la façon dont celles-ci ont impliqué différents mode de pensée. (1)
Le second est un article s’intitulant «Prendre le pli des techniques», il est du philosophe Bruno Latour. Celui-ci revient sur la notion de mode d’existence de l’objet technique, introduite dans la pensée des techniques par Gilbert Simondon. (2)
Avec le numérique, nous parlons d’une technique très diverse, aux multiples visages.Toutefois la grammaire codificatrice qui le fonde soulève des questionnements quant à notre emprise sur les dispositifs qu’il met en place. Des articles d’Internet.actu interrogent la pertinence des algorithmes, et l’autonomie de notre jugement face à la technologie. (3)
D’autre part, malgré la richesse certaine des informations qui sont mises à notre disposition, leur prolifération est loin d’être synonyme de facilité d’accès, dans le sens où leur intégration n’en est pas plus aisée, bien au contraire. Dans son livre intitulé L’Avenir des humanités,Yves Citton, théoricien et professeur de littérature, montre la nécessité de passer d’une économie de la culture à une culture de l’interprétation. (4)
Alain Giffard, quant à lui, nous propose une approche originale du problème en analysant l’exemple plus précis de la lecture numérique. Il met en évidence les conséquences que cette nouvelle technologie de lecture a sur notre façon d’aborder la connaissance. De nombreux articles à ce sujet sont disponibles sur son blog, en voici une petite sélection. (5)
Cette approche à la fois historique et observatrice des pratiques et usages contemporains offre un très bon exemple pour illustrer et approfondir les problématiques que nous avons évoqué.
(1) Delphine Gardey, colloque sur Ecrire, penser, classer
(2) Bruno Latour, «Prendre le pli des techniques»
(3) Internetactu: Sommes-nous encore autonomes? (19/09/2012), La pertinence des algorithmes (29/11/2012)
(4) France Culture: Interview d’Yves Citton sur L’Avenir des Humanités
(5) Alain Giffard: «Des lectures industrielles», «Subjectivités numériques, lectures industrielles», «Lecture numérique et culture écrite», «Le clou et la clé»

Nouveaux savoirs, nouvelles ignorances : l’exemple de la lecture numérique
Article par Alain Giffard Intervention à la réunion du comité des relations internationales scientifiques et techniques de l’Académie des Sciences. (20/11/2006) Certains passages issus d’un article intitulé «la lecture numérique, une activité méconnue» (paru dans la revue du syndicat des librairies). Document téléchargé depuis : http://alaingiffard.blogs.com/culture/2006/11/nouveaux_savoir.html
«Comme l’intitulé de notre réunion l’indique, les technologies de l’information et de la communication interfèrent avec la diffusion du savoir scientifique, et d’ailleurs aussi, au moins pour partie, avec leur production.
Une de ces interférences est le croisement entre la diffusion de l’information et du savoir scientifique, et, précisément les nouveaux savoirs caractéristiques des usages du numérique.
Ces nouveaux savoirs sont essentiellement des savoir- faire. Et ils entretiennent des relations complexes, ambiguës, non seulement avec la culture scientifique et ses propres savoir-faire, mais aussi avec d’autres savoir- faire génériques, culturels au sens large (…).
Je vous propose de nous concentrer sur un exemple (…): le savoir lire, autour de l’exemple de la lecture numérique.
Codification de la connaissance
Mais, au préalable, je voudrais souligner la principale caractéristique de ces nouveaux savoirs (précisément en tant que savoir-faire) : ils reposent sur une codification de la connaissance portée par les technologies de l’information. La codification de la connaissance, en général, convertit la connaissance en un contenu reproductible, par exemple un manuel imprimé, ou un programme informatique. Elle permet classiquement de stocker la connaissance à l’extérieur, d’extérioriser la mémoire.
Elle suppose trois composantes : un langage qui peut s’appliquer à diverses connaissances, du vocabulaire technique à l’intelligence artificielle ; une modélisation qui est l’application spécifique de ce langage à la connaissance visée, du traité de grammaire au moteur de recherche ; un support technique qui assure la conservation et la reproductibilité du produit de la modélisation, du rouleau de papyrus au numérique.
Les technologies de l’information jouent selon différentes directions. Elles disposent d’un langage qui permet de simplifier la codification des connaissances «factuelles», «élémentaires» et, en même temps, elles poursuivent, avec l’intelligence artificielle, l’objectif de modéliser des connaissances complexes. La numérisation garantir l’extériorisation de la connaissance sur différents supports, et, en même temps, elle impose une codification minimale. Un exemple pour illustrer cette notion de codification des savoirs : la Société Boeing, qui avait été à l’origine d’un premier langage de description des documents (GML), a ensuite développé des logiciels d’aide à la maintenance des avions s’appuyant sur la documentation technique au format SGML ; elle s’intéresse aujourd’hui à la codification de la formation à la maintenance. On a là, je crois, un exemple de la montée de la codification de l’information à la connaissance. Il faut préciser que le seul transfert sur un nouveau support n’entraîne pas une nouvelle codification de la connaissance, mais une simple codification de l’information selon les normes du nouveau support. Un traité de grammaire, codex manuscrit ou livre imprimé, représente une certaine codification du savoir du grammairien. La seule numérisation du livre ne crée pas une nouvelle codification du savoir : pour cela, il faudra réaliser, dans l’ordre de l’informatique, l’équivalent du travail de codification dans l’ordre de l’écrit imprimé. C’est tout le problème de l’usage des technologies de l’information dans l’enseignement.
Lecture numérique, un nouveau savoir ?
J’emploie la notion de lecture numérique pour la distinguer de la lecture à l’écran, afin de rendre compte précisément de l’idée d’un nouveau savoir faisant appel à la codification. (…) La lecture numérique a affaire aux spécificités du texte numérique, ce à quoi renvoie la notion d’hypertexte, et elle met en œuvre un nouveau savoir, une technologie propre de lecture reposant sur la codification du savoir-lire. (…)
Six activités permettent de décrire le savoir en œuvre dans la lecture numérique : navigation, marquage, copie, prospection, structuration, annotation (2). Je laisse pour la fin la navigation.
– Le marquage de lecture est effectué à travers les signets ou marque-pages. (…) Le marquage par les signets permet de sélectionner des sites, et de les réserver soit en vue d’une future lecture, soit pour préparer certains traitements ultérieurs.
– La copie numérique, particulièrement facile et puissante, est partout : pour télécharger, enregistrer, imprimer, ou adresser. La lecture numérique s’accompagne d’une prolifération des copies à laquelle nous avions été préparés par la photocopie. Ces copies numériques ne sont rien d’autre que des versions de lecture : il faut adapter le format et la lisibilité, sélectionner, enregistrer, constituer la bibliothèque numérique personnelle.
– La prospection consiste à appliquer au texte des opérations de traitement automatisées ou semi- automatisées d’ordre logico-linguistique. Le grand public utilise surtout les moteurs de recherche et les aides à la traduction. Un point important pour la lecture est l’intégration de ces outils de prospection au poste de travail personnel.
– La structuration, c’est la mémoire. Comme tout lecteur, le lecteur numérique veut garder une trace de ses lectures et pouvoir se livrer ultérieurement à une remémoration. Après les moyens déjà bien établis des listes de liens classés et des dossiers, des logiciels Web 2.0 proposent des interface d’accès à l’internet qui permettent de classer les textes reçus automatiquement ou recherchés (3).
– L’annotation est l’opération qui permet de soutenir une future lecture, ou d’associer un commentaire au texte. La publication d’annotations est très répandue sur les blogs : soit directement (c’est le sens original de la notion de web-log, journal de lecture du web), soit indirectement à travers les commentaires déposés sur les articles.
Le lecteur partage ses propres repères, soit en dressant une liste (roll) de liens sur son blog, soit en participant à une indexation collective et publique (tags). Il a d’ailleurs la possibilité de mettre en circulation, directement, les textes qui l’intéressent (RSS). Finalement les blogs peuvent être analysés comme une grande procédure de publication de lectures. Ainsi le lecteur est constamment engagé dans une sorte de lecture collaborative, qui non seulement conditionne le succès de la sienne, mais est au fondement même du fonctionnement du web.
Si le web est devenu aussi facilement un nouvel espace public pour la lecture, c’est qu’il est fondamentalement non seulement un réseau de textes, un type de littéralité numérique, mais aussi un réseau technique de lectures : la navigation repose fondamentalement sur le lien hypertextuel, qui n’est rien d’autre, de ce point de vue, qu’un dispositif technique de lecture.
Naviguer, est-ce lire ?
(…) Partons d’un fait d’expérience facile à observer : le recours à l’imprimante. Le lecteur suspend son activité de recherche, de navigation, de consultation ; il lance l’impression de la note, de l’article, a fortiori du rapport ou de l’étude, et poursuit sa lecture sur des feuilles de papier imprimées. Il faut donc supposer que la fatigue visuelle et cognitive de la lecture à l’écran est plus importante dans le cas d’une lecture soutenue ou approfondie. Certaines études sur le sujet (4) constatent d’ailleurs une réduction de la lecture approfondie en environnement numérique. Or cette lecture soutenue est la forme matérielle de la lecture d’étude qui s’est construite , pour l’Occident, autour du lien établi, depuis le XIIème siècle, entre lectio et meditatio.
La lecture numérique excelle pour la lecture d’information et la lecture d’exploration, ce à quoi correspond la notion de navigation ; elle achoppe sur la lecture d’étude. (…) Parler d’une lecture d’étude numérique, c’est viser une lecture qui tirerait le plus grand parti du potentiel numérique du texte pour un travail d’étude, ce qu’on appelle l’hypertexte, c’est à dire une lecture qui s’appuierait sur une profusion presque infinie d’entrées et de chemins. (…) Pour le moment, alors que la lecture d’information dispose d’une base numérique assez complète, la lecture d’étude reste, dans le meilleur des cas, une lecture assistée par l’ordinateur et l’internet, un processus hybride qui alterne les opérations de traitement informatique et les phases de réflexion approfondie à partir du papier. Une autre solution est évidemment concevable : celle qui verrait le développement de logiciels de lecture numérique respectant à la fois la richesse du potentiel numérique, la logique des savoirs liés aux différentes lectures (information, étude), et la possibilité pratique d’articuler selon différentes stratégies de lecture les fonctions que j’ai rapidement mentionnées (7).
Ignorances assistées par ordinateur ?
(…) Les lecteurs confirmés n’ont pas de difficultés à maîtriser le caractère hybride de la lecture d’étude numérique. Ils ne confondent pas information et connaissance ; ils ont appris à suspendre la navigation pour mieux se concentrer ; ils jonglent avec les formats, s’ils estiment nécessaire de compléter leur travail par une prospection informatique du texte, ou plus simplement pour conserver leurs annotations. Mais la situation est bien différente pour le lecteur débutant ou peu expérimenté, qu’il s’agisse de sa compétence de lecture en général, ou de sa maîtrise de la technique. Ici les risques de désorientation sont grands : on navigue sur la toile, rebondissant d’information en information, et on croit lire. Ce risque est renforcé par le fait que l’ingénierie de la lecture d’information ne correspond nullement à un savoir de débutant. Les moteurs de recherche, par exemple, sont une combinaison assez complexe d’indexation intégrale, et d’utilisation des liens hypertextuels pour produire un classement qui figure la pertinence des résultats.
Autrement dit le lecteur débutant est dans une posture de simulation décalée puisqu’il met en œuvre des traitements automatisés correspondant à une compétence de lecture qu’il ne possède pas. Le risque de mauvaise lecture ne tient pas à la technologie. Il n’est pas, comme on a pu le dire, inhérent à l’hypertexte. Mais la confusion sur le type de lecture (information ou étude) et le manque de maîtrise de la technologie peuvent se renforcer et produire de telles mauvaises lectures. Ces risques de nouvelles ignorances sont attachées comme une ombre aux nouveaux savoirs réels construits autour des pratiques numériques. Les anglais parlent de « reading without literacy «, qu’on pourrait traduire, sur un mode funèbre, par « lecture illettrée «, ou, plus sobrement, «lire sans savoir lire».
Constituer et apprendre le savoir-lire numérique
Quelques mots, pour conclure, sur les conditions sociales de développement de ces savoirs. Le cadre dans lequel se met en place la lecture numérique est d’une nouveauté radicale dans l’histoire de la lecture.
Les pouvoirs publics, politiques ou religieux, qui, à d’autres époques, jouaient le rôle principal, n’ont presque aucune influence directe sur le processus, ayant décidé, dans beaucoup de pays, de ne pas influer sur l’orientation des logiciels, et dans la plupart, de se limiter à une vision étroite et empiriste de «l’alphabétisation numérique». Les technologies de l’information relèvent donc d’un projet industriel, et il convient de mesurer le changement inouï que représente un savoir-lire d’origine industrielle. Un projet tel que Google Print va nécessairement confronter le lecteur à cette situation paradoxale d’accéder à des textes prédisposés à une lecture d’étude, sans dispositif technique explicitement conçu à cette fin.
Dans cette situation, il est notable que le développement réel de la lecture numérique provient d’un troisième acteur, désigné habituellement comme l’usager, et que j’ai proposé d’appeler le (s) lecteur (s) numérique (s). Dans d’autres contextes, on parlera de « société civile », de « public » , ou d’ « amateur ».
Le rôle de ce nouveau sujet collectif, véritable co- producteur de la culture numérique, est une question des plus fascinantes. De là proviennent sans doute des textes, des lectures, et toutes sortes de nouveaux objets éditoriaux. Il apparaît que le public du numérique, le politique s’abstenant et l’offre industrielle ne le satisfaisant pas, a décidé de faire de ces nouveaux savoirs ses propres « objets «, mais cette nouvelle société des lecteurs numériques est-elle à même de produire une technologie de lecture complète, intégrant l’étude ?»
(1) Thomas Crump, Anthropologie des nombres, Seuil, 1995.
(2) J’ai essayé de replacer ces fonctions dans leur historicité, dans Idée du lecteur , in « Nouveaux médias, nouveaux langages, nouvelles écritures «, Editions L’entretemps, 2005.
(3) Par exemple, le logiciel Netvibes.
(4) Ziming Liu, Reading behavior in the digital environment : Changes in reading behavior over the past ten years, Journal of Documentation, vol.61 n°6, 2006.
(5) Jacques André,Alain Paccoud, Ecrire pour l’écran, irremplaçable typographie, dans La lecture numérique: réalités, enjeux et perspectives «, Presses de l’ENSSIB, 2004. (6) Hartmut Obendorf et Harald Weinreich, Comparing link marker vizualisation techniques – Changes in reading behavior, Université de Hambourg, 2006.
(7)Alain Giffard, La lecture numérique à la Bibliothèque de France, à paraître, aujourd’hui sur http://alaingiffardblogs.com
Mettant à jour les spécificités de cette nouvelle activité qu’est la lecture numérique, Giffard soulève des problèmes plus généraux quant à notre attitude vis-à-vis des technologies de l’information et de la communication. Parce qu’il y a une richesse (une surabondance?) de contenus ne signifie pas que l’apprentissage et l’étude nécessaire à toute construction intellectuelle sont plus aisés. L’apparente facilité d’usage de ces technologies masque un véritable savoir-faire à acquérir, autant qu’une partielle incompatibilité avec les tâches que nous leur assignons. L’usage exhaustif de l’informatique dans des travaux de mise en forme – non seulement textuels mais aussi de son et d’image – tend à l’installer comme un seul médium remplaçant efficacement tous les autres. L’apparente synthèse qu’il opère entre plusieurs techniques nous pousse plus ou moins consciemment à le mettre à la base de notre activité productrice alors qu’il n’en est que le moyen. Constamment placer ‘‘le numérique’’ en sujet, c’est nous refuser de le penser aussi et surtout en tant qu’objet, et d’une certaine façon perdre son contrôle.
En tant que designers, ces questions de ‘‘savoir-Faire numériques’’ sont intéressantes dans ce qu’elles introduisent comme réflexion sur l’utilisation d’une technique particulière, technique qui est notre matériau quotidien. Cela nous pousse à (re)penser à la façon dont nous l’utilisons, à ce qu’elle modèle de nos représentations, de nos mises en forme, et même de nos méthodes de réflexion.
D’autre part, l’émergence de ces nouvelles typologies d’usage est un terrain riche d’observations et de création pour un designer: Comment faciliter la tâche de l’utilisateur des techniques numériques sans rien cacher de leurs spécificités ? Comment ajuster plus étroitement la forme numérique à ses contenus prolifiques ? Et pourquoi pas, quelles alternatives à cette forme, quelles hybridations possibles avec des techniques plus traditionnelles ? Ré-inventer le langage numérique, jouer avec, et non pas l’accepter comme un objet portant en lui-même sa propre justification.